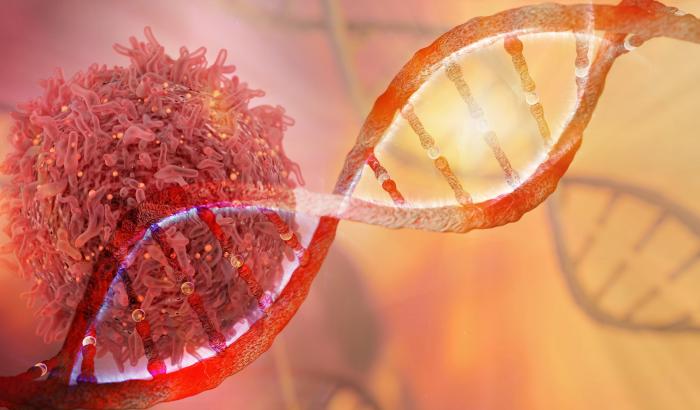Adobe Stock/wladimir1804
La prise en charge de patients atteints de la maladie de Parkinson repose sur une approche multidisciplinaire.
Au Luxembourg plus de 3 000 personnes ont été diagnostiquées avec la maladie de Parkinson et quelque 150 experts mènent des travaux de recherche sur cette pathologie. La neuroscientifique Prof. Dr Anne Grünewald et le chercheur clinicien (neurologue et neuroscientifique) Prof. Dr Rejko Krüger expliquent où en sont aujourd'hui la thérapie et la recherche, et comment les activités de recherche menées au Luxembourg bénéficient concrètement aux patients.
Anne Grünewald dirige un laboratoire de recherche au Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) de l'Université du Luxembourg et Rejko Krüger est professeur en neurosciences au LCSB, coordinateur médical du ParkinsonNet au Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) et du Centre national d'excellence pour la recherche sur la maladie de Parkinson (NCER-PD) au Luxembourg Institute of Health (LIH).


À gauche : Anne Grünewald; à droite : Rejko Krüger.
Le tremblement des mains est un symptôme typique de la maladie de Parkinson, mais il peut aussi avoir d'autres causes. Comment le médecin établit-il le diagnostic ?
RK : Actuellement, le diagnostic repose sur un examen physique réalisé par un neurologue expérimenté et spécialisé dans les troubles moteurs. En effet, la maladie de Parkinson se caractérise principalement par des troubles moteurs, tels que les tremblements, la rigidité musculaire, la lenteur dans la marche ou les déplacements et l'instabilité, qui entraîne une plus grande propension à tomber. Le tableau de la maladie comprend aussi d'autres symptômes que l'on n'associerait pas spontanément à la maladie de Parkinson quand on n'est pas spécialiste. Parmi eux figurent la constipation chronique, les troubles de l'odorat et les troubles du sommeil.
La maladie de Parkinson est donc plus qu'un trouble moteur ?
RK : Tout à fait. Quelque 30 % des personnes concernées présentent un léger trouble de la mémoire au moment du diagnostic et 80 % en développent un au cours de la maladie. La maladie de Parkinson est une maladie complexe et ne se limite pas à un problème moteur.
Quel âge ont les personnes au moment du diagnostic et quelle est leur espérance de vie avec cette maladie ?
RK : La maladie de Parkinson touche principalement les personnes âgées. Il m'est certes déjà arrivé de diagnostiquer des patients âgés de 20 ans, mais les symptômes apparaissent généralement une fois passée la soixantaine. La maladie est légèrement plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Je tiens cependant à souligner que si la maladie de Parkinson est prise en charge correctement dès le diagnostic, l'espérance de vie reste inchangée. Selon les études, certains patients ont tendance à ne pas prendre les médicaments prescrits et à les garder « pour plus tard », quand la maladie aura progressé, par crainte qu'ils ne fassent plus effet à ce moment-là. Je n'y suis pas favorable. Il est essentiel que les patients suivent le traitement adéquat, au bon moment et au bon dosage, pour éviter des complications comme des troubles de la coordination motrice, voire des chutes susceptibles de réduire l'espérance de vie. À aucun stade de la maladie, ils ne se retrouveront dans une situation où ils auront « épuisé les possibilités de traitement ». Il existe toujours des possibilités de traitement pour la maladie de Parkinson.
En 2023, des chercheurs luxembourgeois, en collaboration avec des collègues de l'Université japonaise Juntendo, ont jeté les bases d'un test sanguin pour détecter la maladie de Parkinson. Les médecins s'en servent-ils déjà ?
RK : Le test sanguin est en cours de développement, mais il ne s'agit pas encore d'un examen standard dans les cabinets médicaux. Il est toutefois courant d'effectuer un test génétique dans les cas où la maladie de Parkinson est diagnostiquée avant l'âge de 50 ans ou en présence d'antécédents familiaux évocateurs afin de confirmer le diagnostic. Ce test permet de déterminer si la personne en question appartient au sous-groupe rare de patients porteurs d'une mutation génétique spécifique. Ce critère qualifie un patient pour des essais cliniques qui visent à traiter les causes de la maladie de Parkinson et qui sont susceptibles, à terme, de devenir les premières approches de la médecine de précision.
Les causes de la maladie de Parkinson
Après la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente et touche près de 2 % de la population âgée de plus de 60 ans. Les troubles moteurs liés à la maladie de Parkinson résultent du vieillissement précoce des cellules nerveuses au niveau de la substance noire du cerveau moyen. Ces cellules nerveuses produisent une substance, la dopamine, qui joue un rôle important en tant que neurotransmetteur au niveau du cerveau, notamment pour l'exécution des mouvements et le contrôle du comportement. Au moment du diagnostic de la maladie de Parkinson, une grande partie de ces cellules nerveuses a déjà été détruite, ce qui provoque les symptômes typiques de la maladie. Nous savons toutefois que non seulement les cellules nerveuses qui produisent de la dopamine sont touchées, mais que d'autres neurotransmetteurs au niveau du cerveau sont aussi affectés par la maladie et peuvent favoriser, par exemple, les dépressions ou les troubles de la mémoire.
Source : www.parkinson.lu
Que sait la recherche à propos des causes de la maladie de Parkinson ?
AG : Nous partons du principe que la maladie résulte d'une interaction entre la génétique, les facteurs environnementaux et l'âge. Près de 10 % des cas sont dus à une seule mutation génétique. D'autres gènes à risque, comme les mutations du gène GBA1, renforcent la prédisposition à la maladie. Ces altérations influencent la fonction de certaines protéines et affectent certaines cellules nerveuses dans le cerveau. Dans l'une de nos publications les plus récentes, nous avons aussi pu démontrer qu'une combinaison de plusieurs variations génétiques prises isolément ne déclenche pas la maladie, mais que, collectivement, ces variations sont associées à un risque plus élevé de développer la maladie de Parkinson. Ces variations concernent le fonctionnement des mitochondries, de petites centrales dans nos cellules qui transforment la nourriture en énergie.
Il a été démontré que des facteurs environnementaux comme les pesticides ou les solvants peuvent aussi provoquer la maladie de Parkinson. Chez les patients concernés, on observe souvent des dépôts de la protéine alpha-synucléine dans les cellules nerveuses. Les pesticides ou les solvants favorisent la formation d'amas d'alpha-synucléine. En outre, les traumatismes crâniens, d'autres maladies, comme le diabète, ainsi que le mode de vie, jouent aussi un rôle. L'activité physique peut ainsi ralentir la progression des altérations au niveau du cerveau.
N'existe-t-il pas, à ce jour, de moyen pour détecter la maladie à un stade précoce ?
AG : Une fois que les symptômes typiques de la maladie de Parkinson apparaissent, près de la moitié des cellules nerveuses concernées ont généralement déjà été détruites. Il serait donc judicieux de détecter la maladie plusieurs années avant qu'elle se déclare et de miser sur de futurs traitements pour en ralentir la progression dès le stade précoce de la maladie. Il s'agit là d'un axe de recherche essentiel. Beaucoup d'études portent actuellement sur des personnes qui présentent un risque élevé de développer la maladie de Parkinson, chez qui la maladie ne s'est pas encore déclarée.
Le secteur de la recherche au Luxembourg est partenaire de l'étude « Vieillir en bonne santé » (HeBA). Cette étude lancée en 2022 a pour objectif d'identifier ces personnes et compte déjà plus de 8 700 participants. L'étude est menée conjointement par des chercheurs luxembourgeois et des centres de recherche en Allemagne, en Autriche et en Espagne, alors que les données sont centralisées ici au LCSB. Parmi les groupes à risque déjà connus figurent, par exemple, les personnes souffrant d'un trouble particulier du sommeil. Le risque pour ces personnes de développer la maladie de Parkinson dans les dix prochaines années est de 80 %.
Comment la maladie de Parkinson est-elle traitée aujourd'hui ? Toutes les thérapies sont-elles disponibles au Luxembourg ?
RK : Puisque la maladie de Parkinson ne peut pas encore être guérie, le traitement a pour objectif d'atténuer les symptômes. Les médicaments compensent le manque de dopamine dans le cerveau ou en empêchent la dégradation. À cela s'ajoutent la kinésithérapie ou l'ergothérapie. Dans les stades avancés de la maladie, certains patients peuvent bénéficier de pompes qui administrent les médicaments en continu. Près de 10 % des patients peuvent aussi se voir implanter un dispositif de stimulation cérébrale. Les patients au Luxembourg sont traités selon les normes internationales les plus récentes. Les personnes concernées ont accès à toutes les options thérapeutiques disponibles dans le monde et peuvent se voir prescrire tous les médicaments existant sur le marché.
Mais surtout, depuis 2018, les patients au Luxembourg peuvent intégrer le ParkinsonNet, un réseau de prise en charge inspiré du modèle néerlandais. Dans ce cadre, une équipe pluridisciplinaire accompagne le patient tout au long de sa thérapie. Des études menées aux Pays-Bas ont montré que la mortalité des patients atteints de la maladie de Parkinson est plus faible lorsqu'ils sont pris en charge par des équipes plutôt que par un système de santé non coordonné. Notre réseau est composé de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, de psychologues, de diététiciens, de personnel soignant spécialisé dans la maladie de Parkinson et de neurologues. La prise en charge des patients requiert l'intervention de jusqu'à 19 types de professionnels. Nous en avons déjà réuni huit et les formons lors de cours du soir. Tout patient qui n'est pas encore membre du ParkinsonNet peut s'y inscrire (voir encadré).
ParkinsonNet Luxembourg – le réseau pour les patients
Le ParkinsonNet est un concept originaire des Pays-Bas qui vise une prise en charge intégrée des patients atteints de la maladie de Parkinson. Il améliore en permanence les échanges entre les patients et les spécialistes, et propose un traitement optimal fondé sur les dernières données scientifiques. Les membres ont accès à des spécialistes et sont invités à soutenir la recherche. En outre, le réseau propose des formations continues pour les médecins et les professionnels de santé.
Le réseau ParkinsonNet Luxembourg est gratuit pour les patients et les coûts sont pris en charge par la CNS. Plus de 500 patients sont déjà membres du réseau. Des informations supplémentaires pour les patients, les familles et les médecins sont disponibles sur le site www.parkinsonnet.lu, par téléphone au +352 44 11 66 35 ou par e-mail à l'adresse info@parkinsonnet.lu.
Pourquoi la prise en charge des patients atteints de la maladie de Parkinson repose-t-elle sur autant de disciplines ?
RK : La maladie de Parkinson est chronique, touche principalement des personnes âgées qui présentent souvent déjà d'autres affections et se manifeste sous de nombreuses formes. Les symptômes varient d'un patient à l'autre. Certains, par exemple, ne présentent pas de tremblements – et les causes diffèrent, elles aussi. Comme la maladie peut prendre différentes formes, chaque patient a besoin d'un traitement individualisé qui associe des médicaments et d'autres mesures thérapeutiques. L'orthophoniste, par exemple, peut aider les patients qui souffrent de troubles de la déglutition à réapprendre à avaler et à prévenir les pneumonies dues à des aliments avalés de travers. Des infirmières spécialisées sensibilisent les proches afin qu'ils veillent à ce que les médicaments soient pris correctement. Le kinésithérapeute aide les patients à réduire leur risque de chutes et de fractures, ce qui permet d'éviter des opérations et des rééducations coûteuses. Des études menées aux Pays-Bas montrent déjà que la prise en charge par des équipes pluridisciplinaires réduit les coûts liés à la maladie de Parkinson pour le système public de santé.
Comment pourrait-on améliorer le traitement de la maladie de Parkinson et quelles pistes de recherche semblent les plus prometteuses ?
AG : Par le passé, les travaux de recherche ont permis de réaliser de grands progrès pour atténuer les symptômes de la maladie. Aujourd'hui, de nouvelles méthodes visent à mieux comprendre les mécanismes moléculaires à l'origine de la maladie de Parkinson et à développer des thérapies qui agissent sur ses causes. Comme mentionné plus haut, on observe souvent chez les patients atteints de la maladie de Parkinson des dépôts de la protéine alpha-synucléine dans les cellules nerveuses. Cette protéine, parmi au moins dix autres, fait l'objet de travaux de recherche approfondis. Nous cherchons à comprendre comment les protéines transmettent les signaux et interagissent entre elles, autrement dit comment un défaut au niveau des protéines entraîne la mort des cellules nerveuses et à quel niveau une intervention permettrait d'enrayer la maladie.
Une autre approche consiste à analyser les différents profils génétiques des patients, à les classer en sous-groupes et à adapter les thérapies spécifiquement à ces groupes. C'est ce que nous appelons la médecine de précision (voir encadré « FNR Award »). Au Luxembourg, les personnes porteuses d'une mutation du gène GBA1, qui sont associées à un risque nettement plus élevé de développer la maladie de Parkinson, représentent près de 12 % de l'ensemble des patients atteints de la maladie de Parkinson. Les entreprises pharmaceutiques développent déjà des médicaments spécifiques pour ce groupe.
Récompense pour une approche thérapeutique personnalisée
Le Prof. Rejko Krüger et le Dr Ibrahim Boussaad ont présenté la preuve de concept d'une thérapie personnalisée capable d'aider les personnes atteintes d'une forme familiale rare de la maladie de Parkinson, qui pourrait aussi servir de modèle pour les formes plus courantes. Ce sous-groupe rare se distingue par la présence d'une mutation d'un gène spécifique. Le traitement reposait sur la combinaison d'un médicament déjà approuvé et d'un autre principe actif. Ces substances ont corrigé le défaut présent dans les cellules des patients et ont agi sur la cause même de la maladie. Les chercheurs ont par ailleurs pu démontrer que ces mécanismes interviennent aussi dans d'autres gènes et que ces altérations sont plus fréquentes chez les patients atteints de la maladie de Parkinson que chez les personnes en bonne santé. Ce traitement pourrait donc aussi aider d'autres groupes de patients atteints de la maladie de Parkinson. Une plateforme robotisée de criblage de médicaments, développée par les chercheurs dans leur laboratoire grâce au soutien du programme PEARL du FNR, s'est révélée très utile dans ce contexte. Pour ces performances, Rejko Krüger et Ibrahim Boussaad ont reçu en 2022 le « FNR Award 2022 for Outstanding Scientific Achievement ».
Les avancées technologiques majeures des vingt dernières années jouent un rôle clé dans ce contexte. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de cultiver en laboratoire des structures miniaturisées du cerveau à partir de cellules souches prélevées sur la peau des patients. Nous pouvons travailler sur des cellules nerveuses vivantes et décrypter les informations génétiques en un temps record. À cela s'ajoutent la digitalisation et l'intelligence artificielle, qui permettent de traiter d'immenses ensembles de données. Les technologies basées sur l'intelligence artificielle permettent de prédire la structure de protéines et de fournir des résultats en quelques heures, une procédure qui, autrefois, prenait des années. La moitié de nos chercheurs au LCSB sont spécialisés en bio-informatique. Je suis persuadée que cette collaboration interdisciplinaire entre biologistes et experts en informatique, associée à l'intelligence artificielle, recèle un potentiel considérable. Toutes ces avancées feront progresser beaucoup plus rapidement la recherche. De plus, la coopération internationale s'intensifie. Les chercheurs travaillent aujourd'hui avec des cohortes massives de patients provenant de nombreux pays.
Selon vous, la recherche approche-t-elle d'un tournant déterminant ?
RK : Il n'y aura probablement pas un seul tournant déterminant, mais plutôt une succession de découvertes continues qui se complètent. Il y a vingt ans, des chercheurs ont découvert que la protéine alpha-synucléine forme des amas dans le cerveau de tous les patients atteints de la maladie de Parkinson. Une étude prometteuse a récemment montré que des anticorps ciblant précisément cette protéine peuvent ralentir l'évolution de la maladie chez des patients. Des études cliniques supplémentaires sont encore nécessaires pour confirmer ces résultats. Mais ce serait formidable si nous pouvions ralentir ainsi l'évolution naturelle de la maladie. Cet exemple illustre combien il faut de temps à la recherche entre la découverte et la mise au point d'un traitement, et montre que chaque étape repose sur la précédente.
Il y a dix ans, les acteurs de la recherche au Luxembourg, à savoir le LIH, le LCSB, BioBank (IBBL) et le CHL, se sont réunis pour former le « Centre national d'excellence pour la recherche sur la maladie de Parkinson », ou NCER-PD. Quels résultats ce travail de recherche conjoint, qui bénéficie du soutien du FNR, a-t-il permis d'obtenir ?
AG : Sur le plan de la recherche, nous avons développé ensemble de nouveaux biomarqueurs pour le diagnostic précoce. Nous avons aussi acquis des connaissances essentielles sur les mécanismes de la neurodégénérescence liée à la maladie de Parkinson et avons constitué l'une des plus vastes cohortes de patients d'Europe, qui comprend des profils génétiques et des échantillons sanguins de plus de 1 000 patients atteints de la maladie de Parkinson et de plus de 300 personnes à risque. Grâce à cette cohorte, qui est actuellement coordonnée par le LIH, et à nos résultats de recherche, le NCER-PD au Luxembourg jouit aujourd'hui d'une reconnaissance mondiale.
Les travaux de recherche menés au Luxembourg sur la maladie de Parkinson sont donc reconnus à l'échelle internationale ?
AG : Grâce au NCER-PD, le Luxembourg a pu se positionner sur la scène mondiale de la recherche sur la maladie de Parkinson et participer activement à la Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI), qui bénéficie du soutien de la Fondation Michael J. Fox. Le Luxembourg est l'un des 51 sites cliniques dans le monde à participer à cette étude clinique d'observation pionnière. Cette participation a permis à notre cohorte de patients d'acquérir une visibilité internationale. Des chercheurs du monde entier nous contactent pour obtenir des échantillons de patients pour leurs études. La Fondation Michael J. Fox prévoit désormais de regrouper tous les cas de Parkinson, y compris les échantillons de patients, à l'échelle mondiale. Ce projet pourrait permettre des analyses de grande ampleur entre différents pays et faire progresser la recherche plus rapidement. Pour le Luxembourg, faire partie de ce mouvement international est un énorme succès.
Quels avantages concrets les patients d'aujourd'hui en tirent-ils ?
RK : Grâce à des initiatives d'accompagnement comme ParkinsonNet Luxembourg, tous les patients atteints de la maladie de Parkinson au Luxembourg peuvent aujourd'hui bénéficier d'une prise en charge qui repose sur les données scientifiques les plus récentes. Il était important pour nous – et il s'agissait d'une condition pour le financement public – que la recherche et l'innovation menées dans le pays puissent profiter aux patients actuels, et non pas uniquement aux générations futures. C'est ainsi qu'est née l'idée du ParkinsonNet.
Grâce à notre cohorte de patients, les entreprises pharmaceutiques s'intéressent désormais au Luxembourg et y proposent des études cliniques qui permettent aux patients d'accéder plus tôt à de nouveaux médicaments. Par exemple, dès l'automne, jusqu'à quinze patients au Luxembourg atteints de la maladie de Parkinson qui sont porteurs de la mutation du gène GBA1 pourront recevoir une perfusion d'anticorps dans le cadre d'une étude clinique menée avec l'entreprise pharmaceutique Roche. Nous nous attendons à ce que les personnes porteuses de cette mutation génétique réagissent particulièrement bien au traitement. Le médicament ne sera disponible en pharmacie que dans quelques années.
Grâce à son travail de sensibilisation, le NCER-PD a aussi contribué à faire de la maladie de Parkinson un sujet moins tabou aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants au FNR d'avoir soutenu et financé cette recherche dans le cadre du premier programme national d'excellence. Au terme de la période de financement, les fonds tiers que nous avions obtenus dépassaient même les aides publiques luxembourgeoises. La recherche publique profite à la fois aux patients et à la société dans son ensemble.
Auteure : Britta Schlüter
Édition : Michèle Weber (FNR)
Traduction : Nadia Taouil (www.t9n.lu)